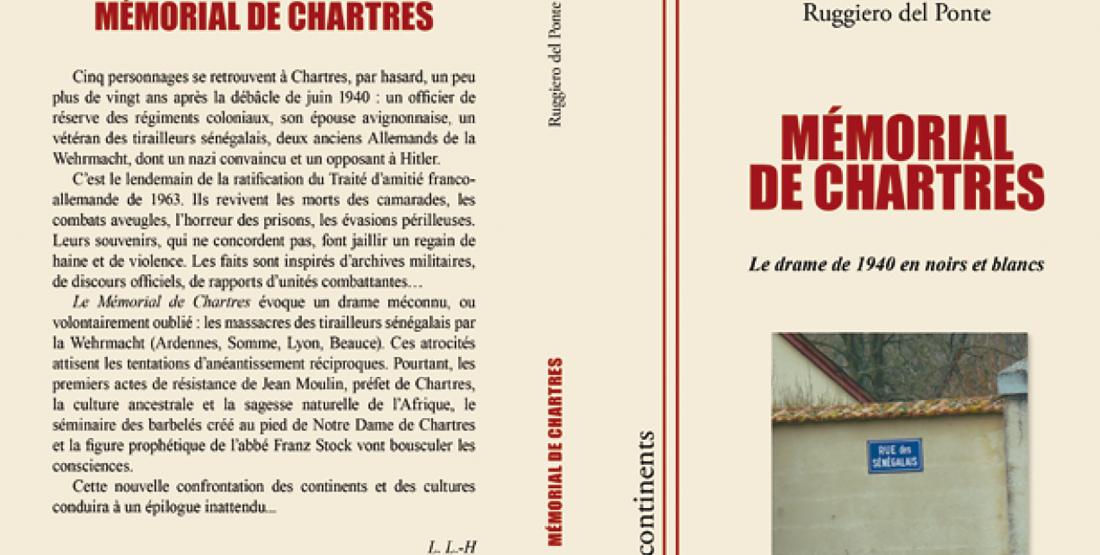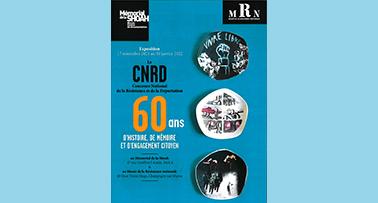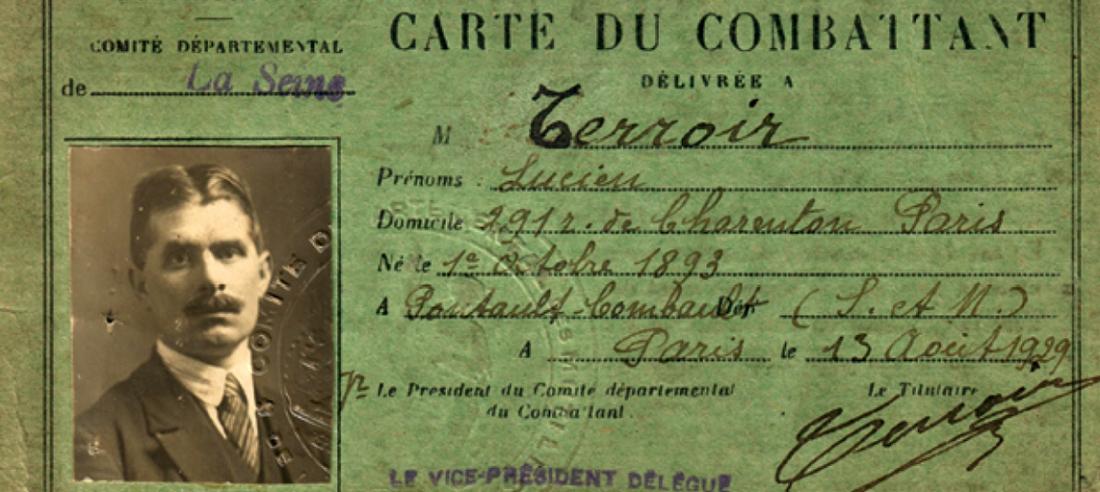Une histoire de la réconciliation franco-allemande

Des prémices de la guerre de 1870 à nos jours, les relations franco-allemandes ont connu soubresauts et rebonds, les deux guerres mondiales symbolisant l’ultime fracture. La fin du XXe siècle marque le temps de l’apaisement et ouvre la voie à un véritable processus de réconciliation. Ainsi, si la relation bilatérale entre l’Allemagne et la France résulte d’années de progressive et intense coopération, elle demeure également indissociable de la construction européenne.